
La vie quotidienne en Nouvelle-France
Comment vivait-on en Nouvelle-France? Comment s’habillait-on? Comment la justice était-elle rendue? Comment les gens étaient-ils soignés? Comment faisait-on la cour? Que mangeait-on? Ce sont là quelques questions, parmi d'autres, auxquelles ces ouvrages répondent.
Les résumés sont adaptés de ceux des éditeurs.
Certains des titres proposés ci-dessous sont disponibles en format adapté pour les personnes ayant une déficience perceptuelle.
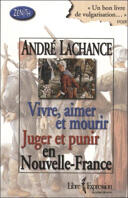
Dans Vivre, aimer et mourir en Nouvelle-France, nous apprenons comment se déroulait l'existence des habitants de la campagne et de la ville, et nous découvrons les coutumes, les usages et les approches qui guidaient leurs gestes. Puis, dans Juger et punir en Nouvelle-France, l'auteur met en vedette criminels, justiciers et victimes, à travers huit récits qui révèlent un autre volet de la vie quotidienne en Nouvelle-France.
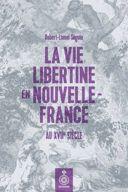
Cet ouvrage lève le voile sur le tabou qu'était la sexualité à cette époque en divulguant de croustillantes anecdotes et de surprenantes révélations sur la vie libertine de nos ancêtres. Le recours au verbatim des témoignages en français du XVIIe siècle rend la lecture savoureuse. Cette nouvelle édition présente des transcriptions en français moderne et de surprenantes gravures de Jean-Honoré Fragonard.

Les annales militaires puis l’historiographie du Régime français nous ont habitués à voir évoluer le milicien canadien presque d’un bout à l’autre de l’épopée coloniale. Le milicien et non les miliciens, voilà le problème, car on a élevé les Canadiens au statut de symbole de bravoure, d’indiscipline, de « canadianité » en somme. S’attaquant au mythe du peuple guerrier, ce livre entreprend de rendre aux miliciens leur pluralité et, par là, une certaine densité humaine.
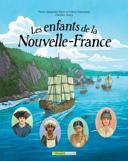
À travers onze portraits d'enfants, le lecteur est invité à explorer les multiples aspects de la vie en Nouvelle-France, à différentes époques, tels que la traversée de l'Atlantique à bord d'un grand voilier, la prise de possession du territoire, l'économie, les vêtements et la médecine.
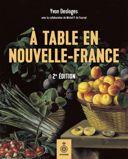
L'alimentation touche au quotidien et à l'identité des gens du pays. En Nouvelle-France, comme ailleurs, elle varie au gré des couches sociales, des saisons, du climat et des prescriptions religieuses et change avec l'amélioration des techniques agricoles. Elle est aussi marquée par le contact des diverses civilisations qu'elle côtoie, tant autochtones qu'anglo-saxonnes.

Pierre Boucher passe quelques années en Huronie avant de s'établir à Trois-Rivières dont il deviendra le gouverneur. Dans cet ouvrage, il livre un puissant portrait du pays, de ses richesses naturelles et de ses habitants. Le roi sera sensible aux arguments de Pierre Boucher en envoyant, entre autres, les Filles du roi et le régiment de Carignan-Salières qui relanceront le développement de la colonie. Une source de première main.

L'auteur nous fait découvrir comment vivaient les citadins – bourgeois et nobles, mais aussi le petit peuple – de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal entre 1680 et 1760. Plusieurs aspects sont évoqués : leur environnement (rues et maisons), leurs besoins fondamentaux (se nourrir, se loger, se vêtir), leurs activités sociales et culturelles, leur instruction, leurs loisirs (cabaret, théâtre, musique, chant et danse) et leur sécurité dans l'enceinte de la ville.
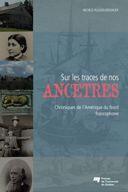
Si nous avons appris les grandes lignes de notre passé commun sur les bancs de l’école, la petite histoire nous est peut-être moins connue. Sur les traces de nos ancêtres dévoile, bribes par bribes, cette petite histoire des francophones d’Amérique du Nord par des récits qui piquent notre curiosité et nous relient intimement à notre passé.

Des historiens, généalogistes et ethnologues relatent l'histoire du Québec à travers les découvertes de Jacques Cartier, les premiers contacts avec les Autochtones, la constitution de la Nouvelle-France, la vie quotidienne et les familles souches au Québec. L'ouvrage séduira autant les historiens et les généalogistes que le public en général.
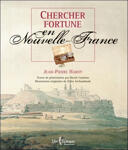
Au péril de leur vie, de jeunes aventuriers ont déserté les Vieux Pays et bravé l'océan Atlantique pour chercher fortune en Nouvelle-France. S'ils survivaient à la traversée, ils affrontaient alors les forêts d'Amérique pour se tailler une terre qui leur permettrait d'assurer leur pain quotidien avant de partir à la découverte de ce vierge.

L'auteur propose un voyage à travers les archives criminelles de la justice royale de la Nouvelle-France. On y apprend comment se rendait la justice et par qui étaient exécutées les condamnations à des peines capitales comme la pendaison ou la roue, et à des peines corporelles, tels le fouet, la marque au fer rouge ou le carcan. On y rencontre ceux et celles qui subissaient ces châtiments mais aussi ceux qui les appliquaient.
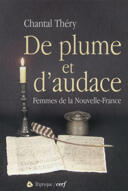
La Nouvelle-France s'est aussi construite et écrite grâce aux femmes. Cet essai rend hommage à celles qui ont choisi d'immigrer et de rendre compte par écrit des difficultés et des bonheurs de leur entreprise, du passage de l'Ancien au Nouveau Monde, de leurs relations avec les Autochtones.
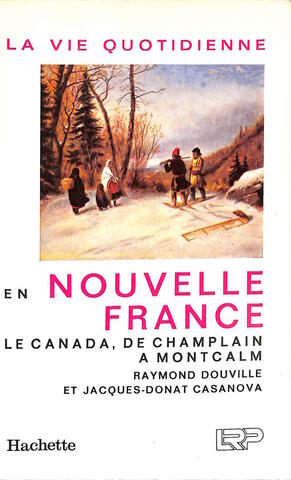
Les auteurs s'appliquent à nous révéler la vie quotidienne des peuples sous tous les aspects. Il est question de l'enracinement de l'émigré, de son adaptation au pays nouveau, de la politique de peuplement de la métropole, de la qualité du colon.
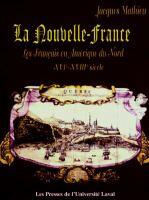
On relate ici l’histoire de la Nouvelle-France, les événements et les pérégrinations. On rappelle des carrières politiques et militaires et on évoque les relations entre les personnes et les institutions. On présente enfin les structures sociales et les rythmes de la vie religieuse et familiale.

Une histoire sociale de la Nouvelle-France, qui fait une part importante, non plus seulement aux Blancs catholiques, mais aussi aux autres groupes : esclaves noirs, prisonniers anglais et Iroquois christianisés. Un chapitre est consacré aux artisans, aux soldats, aux marchands, aux nobles et aux religieux qui peuplaient Montréal et Québec, un autre étudie la situation des femmes.
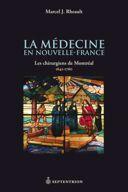
L'ouvrage est basé sur le mémoire de l'auteur présenté en 2000 à l'Université de Montréal et intitulé « Le rôle des chirurgiens-barbiers et des chirurgiens militaires sur la santé et la vie quotidienne des Montréalais sous le Régime français ».


